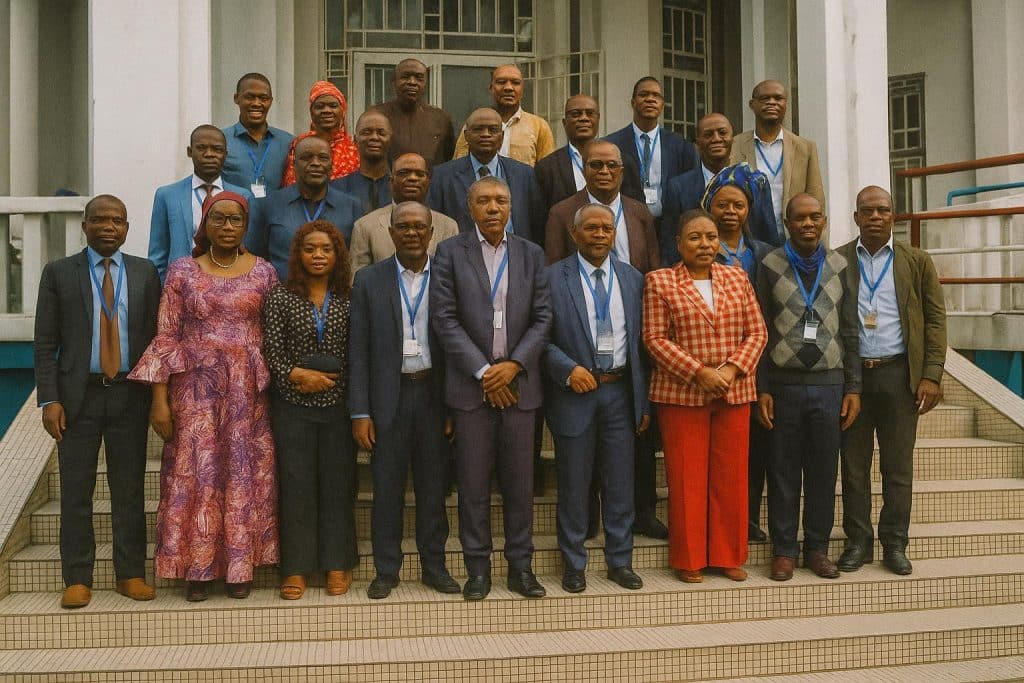Cap vers une résilience assumée
À l’ombre des flamboyants de Brazzaville, le ministère des Affaires sociales et le Programme des Nations unies pour le développement viennent de sceller, après trois jours d’intenses travaux, la version révisée de la Stratégie nationale de relèvement post-catastrophes et de préparation aux crises futures 2025-2030. Lancée en 2021 dans un contexte déjà marqué par les inondations récurrentes du bassin du Congo, cette feuille de route gagne aujourd’hui en maturité. « Notre priorité est de protéger les vies humaines et de restaurer la dignité des sinistrés », déclare d’emblée Mme Carine Ibatta, directrice de l’assistance humanitaire, en ouvrant l’atelier de validation. Du point de vue gouvernemental, l’enjeu dépasse la simple réaction d’urgence ; il s’agit d’wp-signup.php la gestion des risques dans le long terme, en cohérence avec la Vision 2030 et les Objectifs de développement durable.
Une architecture stratégique inspirée du cadre de Sendai
Le document, structuré autour de deux piliers – relèvement et préparation – se nourrit des enseignements tirés des crues de 2023 et des intempéries successives qui ont éprouvé le nord et le Pool. Il épouse les principes du cadre de Sendai, référence mondiale pour la réduction des risques, et traduit cette doctrine en objectifs concrets : rebâtir des infrastructures sociales plus solides, réhabiliter les axes de transport vitaux, soutenir la relance agricole et doter le pays d’un système d’alerte précoce multirisques. Pour Joseph Pihi, spécialiste du relèvement au PNUD, « l’ambition est d’éviter que chaque catastrophe ne ramène les communautés à la case départ ». Ainsi, l’accent est mis sur la continuité des services essentiels ; la reconstruction des écoles intègre désormais une norme de surélévation des fondations, tandis que les centres de santé devront disposer de sources énergétiques autonomes.
Le souffle des partenaires techniques et financiers
Le coût global de la stratégie, estimé à 156,7 milliards de FCFA pour la première phase 2025-2026, témoigne de l’ampleur du chantier. L’État compte mobiliser environ 40 % de l’enveloppe, le reste devant provenir d’une constellation de bailleurs : agences onusiennes, Croix-Rouge, Banque africaine de développement, sans oublier le secteur privé. Le représentant résident adjoint du PNUD souligne « la réactivité et la cohésion institutionnelle inédites observées durant la phase de conception ». De fait, l’atelier a réuni une cinquantaine d’experts issus des ministères sectoriels, de la société civile et de la communauté scientifique – un signe de la tendance à la convergence des agendas. Pour garantir la transparence, le document prévoit la création d’un guichet unique numérique dédié au suivi des décaissements et à la cartographie des projets.
Financement, gouvernance et contrôle citoyen
Au-delà du montage budgétaire, la stratégie introduit un dispositif de gouvernance pensé comme un garde-fou contre l’éparpillement. Un comité interministériel présidé par le Premier ministre pilotera l’exécution, tandis qu’un groupe de surveillance associant ONG nationales et médias urbains examinera trimestriellement les indicateurs de performance. L’universitaire André Goma, spécialiste des politiques publiques, y voit « une innovation institutionnelle susceptible de renforcer la redevabilité sans alourdir la chaîne décisionnelle ». Pour maintenir l’efficience, le texte impose également une évaluation indépendante mi-parcours en 2027, condition sine qua non pour accéder à la seconde tranche de financements concessionnels.
Inclusion sociale et ancrage communautaire
Si les chiffres occupent volontiers le devant de la scène, la dimension humaine reste au cœur du projet. Les femmes, surreprésentées dans les segments informels de l’économie, bénéficieront de programmes de formation à la micro-assurance et au stockage post-récolte. Les collectivités pygmées, souvent isolées, verront leurs zones cartographiées pour l’implantation de radios communautaires capables de diffuser des alertes météo en langue locale. Par ailleurs, le fonds d’urgence, doté de 5 milliards de FCFA, réservera 30 % de ses ressources à des actions menées directement par les communautés, un choix salué par la plateforme citoyenne « Congo-Vert », qui milite pour une gouvernance partagée des risques.
Des défis mesurés, une volonté affirmée
Reste que la réussite du plan dépendra de variables encore mouvantes. La volatilité climatique, l’incertitude économique internationale et la concurrence d’autres priorités budgétaires pourraient ralentir la cadence. Néanmoins, le gouvernement, fort de sa collaboration avec le PNUD, semble misé sur la cohérence des politiques pour surmonter ces obstacles. « Nous avons franchi l’étape de la promesse ; place désormais à l’implémentation méthodique », insiste Mme Ibatta en clôturant les travaux. Dans la capitale, l’annonce a trouvé un écho favorable auprès des organisations de jeunesse, pour qui ce cadre donne enfin une perspective structurée aux initiatives locales de gestion des risques. En filigrane, l’idée que la catastrophe n’est plus le synopsis inéluctable d’un drame, mais l’occasion d’affirmer une capacité de rebond collectif, s’impose progressivement dans le débat public.