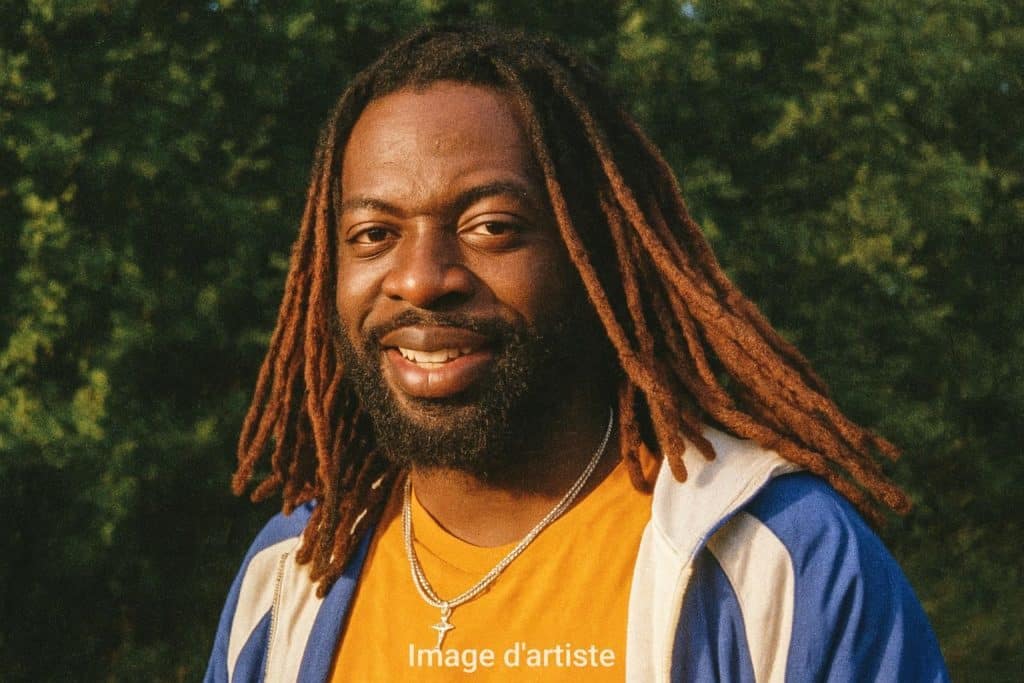Un souffle d’espérance sur la scène du Fespam
Lorsque les projecteurs se sont allumés sur les quelque trois cents interprètes du spectacle d’ouverture de la 12e édition du Festival panafricain de musique, la rumeur d’un public enthousiasmé a envahi le complexe sportif Alphonse-Massamba-Débat. Portée par la vision du chorégraphe Gervais Tomadiatunga, la fresque intitulée « Année de la jeunesse » a déployé ses tableaux comme autant de clins d’œil au renouveau prôné par les autorités congolaises, lesquelles, sous l’impulsion du président Denis Sassou Nguesso, ont placé 2023 sous le signe de la jeunesse et de la créativité. En mêlant percussions, voix urbaines et gestuelle contemporaine, la création a rappelé que Brazzaville, ville-pont entre mémoires et futur, ambitionne de faire de la culture un levier d’épanouissement pour les nouvelles générations.
Les coulisses d’une création à ciel ouvert
Le récit des répétitions, livré en aparté par le maître d’œuvre, laisse entrevoir une aventure quasi spartiate : sol de latérite au cercle culturel Sony-Labou-Tansi, températures à la limite du supportable et huit heures quotidiennes d’entraînement. « La poussière elle-même est entrée dans la dramaturgie », confie Tomadiatunga, rappelant que le manque de confort n’a pas entamé la détermination des danseurs. Cette abnégation est d’abord le fruit d’une politique publique qui mise sur les valeurs d’effort et de résilience inculquées aux jeunes artistes. Elle illustre aussi la conviction de la ministre de l’Industrie culturelle, Lydie Pongault, selon laquelle la production locale dispose des ressources humaines capables de rivaliser avec les compagnies internationales les plus aguerries.
Le pari d’une maîtrise artistique congolaise
Le choix assumé de recourir à un fils du pays pour orchestrer l’événement constitue un signal fort envoyé au secteur. Formé entre Pointe-Noire et Paris, invité régulier des scènes africaines et européennes, Tomadiatunga a su articuler exigences internationales et inspirations vernaculaires. « La jeunesse a démontré qu’elle pouvait porter haut notre culture », s’est-il réjoui en référence à la phrase d’encouragement du chef de l’État. Au-delà de la prouesse scénique, la démonstration porte un message d’autonomie artistique : il est désormais possible de concevoir, monter et exporter un spectacle de grande envergure sans délocaliser l’ingénierie culturelle. Pour de nombreux observateurs, cet accomplissement donne corps à la stratégie nationale d’industrialisation des contenus créatifs, couplée au développement d’infrastructures adaptées.
Danse mopacho: prochaine étape du récit national
À peine les coulisses du Fespam refermées, l’agenda du chorégraphe s’allonge. La commande d’un spectacle autour de la mopacho, danse populaire dont les origines congolaises restent méconnues du grand public, illustre la volonté de documenter le patrimoine immatériel. L’objectif est double : offrir une narration contemporaine à une pratique festive diffuse et renforcer la diplomatie culturelle en redorant un emblème identitaire. Cette perspective, soutenue par le ministère de tutelle, confirme le rôle attribué aux créateurs dans la consolidation du récit national, tandis que les plateformes numériques offriront une vitrine planétaire à cette réinterprétation patrimoniale.
Jeunesse et entrepreneuriat créatif à l’ère du numérique
Le spectacle « Année de la jeunesse » fait également écho à la montée en puissance d’une génération rompu aux outils digitaux, qui s’empare des réseaux sociaux pour monétiser ses œuvres, fédérer des communautés et court-circuiter les circuits traditionnels de diffusion. L’auto-entrepreneuriat culturel, encouragé par des dispositifs d’incubation, s’impose ainsi comme un segment prometteur de l’économie congolaise, à même de compléter les filières extractives. Plusieurs experts soulignent que cet écosystème créatif contribue à l’attractivité du territoire, attirant investisseurs et touristes curieux d’expériences originales.
Vers une diplomatie culturelle renouvelée
À travers le Fespam, Brazzaville consolide sa place de capitale musicale et symbolique du continent. L’événement, né en 1996, n’a cessé d’épouser les évolutions géopolitiques régionales, se transformant en plateforme de dialogue interculturel. La réussite de son ouverture, saluée par les délégations étrangères, confirme que la culture demeure un vecteur d’influence douce privilégié par le Congo-Brazzaville. Dans une conjoncture internationale où la compétition pour la visibilité est de plus en plus vive, l’option d’un soft power bâti sur les arts vivants offre au pays une carte distinctive, irriguée par l’énergie de sa jeunesse.